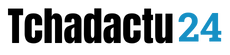L’arrestation spectaculaire du président vénézuélien Nicolás Maduro par une opération militaire américaine, menée au cœur même de Caracas, marque un tournant d’une gravité exceptionnelle dans l’histoire contemporaine des relations internationales. Au-delà de l’événement en lui-même, c’est l’architecture juridique patiemment construite depuis 1945 qui vacille, comme si le droit international, déjà fragilisé, venait d’être relégué au rang de variable d’ajustement face à la loi du plus fort.
Cette intervention, revendiquée sans détour par le président des États-Unis Donald J. Trump, s’inscrit dans une logique de rupture assumée : rupture avec la souveraineté des États, rupture avec le multilatéralisme, rupture enfin avec l’illusion selon laquelle la Charte des Nations Unies constituerait encore un rempart effectif contre l’arbitraire des puissances dominantes.
Quand la force se substitue au droit
L’article 2 de la Charte des Nations Unies interdit explicitement le recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État. Cette disposition n’est ni symbolique ni accessoire : elle constitue le socle normatif de l’ordre international moderne. Or, l’opération ayant conduit à la capture d’un chef d’État en exercice, sans mandat international ni situation de légitime défense reconnue, s’apparente à une négation frontale de ce principe.
Ce qui frappe, ce n’est pas seulement la violation du droit, mais sa mise en scène. Le langage martial employé, la théâtralisation politique de l’opération et la revendication publique d’un contrôle transitoire du pays traduisent une volonté de normaliser l’exception. Le message implicite est limpide : le droit ne s’applique que tant qu’il ne contrarie pas les intérêts stratégiques majeurs.
Dans cette perspective, la Charte des Nations Unies n’est pas officiellement abrogée ; elle est vidée de sa substance par la pratique.
La dérive impériale et la crise de la légalité américaine
Cette opération soulève également une question interne aux États-Unis eux-mêmes. La Constitution américaine confère au Congrès, et non à l’exécutif, le pouvoir de déclarer la guerre. En agissant unilatéralement, l’exécutif renforce une tendance lourde : celle d’une présidentialisation extrême de la politique étrangère, où l’urgence sécuritaire sert de justification permanente à l’érosion des contre-pouvoirs.
L’argument du narcoterrorisme ou narcotrafic, souvent invoqué, fonctionne comme une clé rhétorique universelle : il permet de criminaliser un adversaire politique, de le soustraire au champ diplomatique et de légitimer une intervention militaire sous couvert de moralisation. Ce procédé n’est pas nouveau, mais il atteint ici un degré de radicalité inédit.
En filigrane se dessine une doctrine hémisphérique réactualisée, rappelant les fondements idéologiques de la doctrine Monroe : l’Amérique latine demeure une zone d’influence où la souveraineté reste conditionnelle, subordonnée à l’acceptabilité politique et économique définie à Washington.
L’Europe : entre principes proclamés et impuissance stratégique
Face à cet événement, la réaction européenne révèle une ambivalence chronique. Les déclarations officielles invoquent le respect du droit international, la nécessité d’une transition pacifique et la protection des populations civiles. Pourtant, ces principes restent largement incantatoires.
L’Union européenne apparaît une fois de plus divisée, hésitante, prisonnière de sa dépendance stratégique. Certaines capitales dénoncent timidement, d’autres rationalisent, invoquant la « complexité juridique » ou les « réalités géopolitiques ». Cette posture confirme une vérité dérangeante : l’Europe parle le langage du droit dans un monde qui raisonne désormais en termes de rapports de force.
Cette dissonance affaiblit non seulement la crédibilité européenne, mais aussi l’idée même d’un ordre international fondé sur des règles communes.
L’Amérique latine fracturée, le Sud global lucide
En Amérique latine, la réaction est nettement plus tranchée. Une ligne de fracture idéologique traverse le continent. D’un côté, des gouvernements dénoncent une violation manifeste de la souveraineté et redoutent un précédent aux conséquences régionales incalculables. De l’autre, certains dirigeants saluent l’intervention au nom d’une rhétorique de la liberté, quitte à légitimer l’ingérence étrangère.
Cette polarisation reflète une crise plus profonde : celle de la capacité des États du Sud à se protéger collectivement face à l’unilatéralisme des grandes puissances. La réaction prudente mais critique de la Russie et de la Chine s’inscrit dans une lecture réaliste du monde : elles condamnent moins par attachement au droit que par conscience qu’un tel précédent pourrait un jour se retourner contre elles.
Le choix de Delcy Rodríguez : la stabilité contre le changement
Le choix d’une figure issue du sérail chaviste comme interlocutrice privilégiée pour la transition révèle un pragmatisme assumé. L’objectif n’est pas une refondation démocratique radicale, mais une stabilisation contrôlée, compatible avec les intérêts économiques et stratégiques américains, notamment énergétiques.
Ce calcul interroge la sincérité du discours sur la démocratie. Peut-on réellement parler de libération politique lorsque le changement est piloté, encadré et conditionné par une puissance étrangère ? La continuité déguisée sous les habits de la transition risque de produire une désillusion durable au sein de la société vénézuélienne.
Un monde post-juridique ?
L’affaire Maduro dépasse largement le cadre vénézuélien. Elle pose une question fondamentale : assistons-nous à l’entrée dans un monde où le droit international n’est plus qu’un discours moral, dépourvu de force contraignante face aux grandes puissances ?
Si la capture d’un chef d’État en exercice peut être justifiée, applaudie ou relativisée, alors aucun État n’est véritablement à l’abri. Le précédent est posé. Et avec lui, le risque d’un ordre international régi non plus par des règles partagées, mais par une hiérarchie brutale des puissances.
Dans ce monde en recomposition, la souveraineté n’est plus un droit : elle devient une tolérance.
Publié par : DJAZAM ADEF AHMAT (Juriste et Politologue)